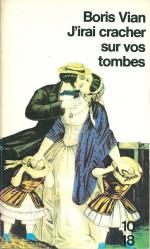Les deux filles noires de Louis XIV :
la Mauresse de Moret et Dorothée

Dans son excellent petit ouvrage, publié en 2012, consacré à la religieuse métisse communément appelée La Mauresse de Moret, Serge Bilé laisse le lecteur libre d'arrêter son jugement personnel sur son ascendance, après une étourdissante promenade dans le dédale des archives et des témoignages littéraires du XVIIIe et du XIXe siècles. Cependant le dernier chapitre du livre, très riche sur les soins que Louis XIV apporta à cette religieuse noire, nous laisse croire que ceux qui continuent à voir en elle la fille de la reine Marie-Thérèse se trompent ou veulent nous tromper.
Certes, dans la culture collective – sauf dans celle de quelques rares irréductibles, comme nous le verrons plus loin – Marie-Thérèse, l'épouse du roi Louis XIV, a mis au monde une fille métisse en novembre 1664. Les petites histoires sur l'excessive consommation du chocolat ou le simple regard d’une personne noire qui produirait des enfants noirs, inventées par son médecin et ses soutiens, n'ont pas suffi pour la laver de son adultère. Et même si la mort de la fille de la reine et la disparition de son père nègre n’ont pas clairement été établies, leur existence fait partie de l'Histoire de France depuis des siècles.
Si malgré cela la polémique autour de la religieuse noire, qui vécut et mourut au couvent des bénédictines de la ville de Moret, ressurgit aujourd'hui et passionne de nouveau les historiens, c'est parce que les archives semblent montrer que l'adultère de la reine Marie-Thérèse – ou son prétendu adultère – était destiné à nier le fruit des relations sexuelles que Louis XIV aurait eues avec une négresse. La question que l'on se pose désormais est donc celle-ci : la Mauresse de Moret, la sœur Louise-Marie de Sainte Thérèse, est-elle la fille – déclarée morte à la naissance – de la reine Marie-Thérèse ou la fille adultérine de Louis XIV ?
Pour celui qui lit attentivement son livre, le récit de Serge Bilé ne peut longtemps entretenir le trouble dans son esprit. Il contient les éléments nécessaires pour donner la ferme conviction que cette religieuse noire était bien la fille de Louis XIV. Ce ne sont pas les affirmations de Saint-Simon et de Voltaire – selon ce dernier, la Mauresse est le fidèle portrait du roi – ni même les contradictions des historiens et de Victor Hugo qui peuvent aider en cela. Au contraire, ce qui nous ouvre les yeux, c'est la ferme négation de l’existence des filles adultérines de Louis XIV, et particulièrement celle des historiens comme Alain Decaux qui – ignorant à la fois la vie sexuelle du roi et son comportement à l’égard de la Mauresse – refusent de croire que le roi ait pu folâtrer avec une négresse.
Que dit l'Histoire de la vie sexuelle de Louis XIV ? En 1919, balayant les scrupules de tous ceux qui ne voulaient pas voir en la religieuse noire la fille du Roi Soleil, l'archiviste Jules Mathorez rappelait en ces termes l’idée que les précédents siècles avaient laissé de lui : « Lorsqu’on se souvient que, pour Louis XIV jeune, tout était bon, pourvu que ce fussent des femmes, et qu’il aima la Beauvais (femme de chambre borgne de la reine mère), des filles de jardiniers, et d’autres personnes de modeste condition, rien ne s’oppose à ce que, vers 1656, Louis XIV ait eu une héritière noire qu’il aurait fait conduire au couvent de Moret ».
L’évidente conviction raciste qui anime Alain Decaux et certains historiens et les pousse à nier la paternité du roi ne peut constituer un argument. Serait-il inconcevable qu’un roi de France ait eu des relations sexuelles avec une Noire ? Le fait d’être roi n’empêchait pas Louis XIV d’être homme. Et comme il avait plus de droit que les autres hommes – sinon tous les droits – il couchait avec qui il voulait. Oui, la réputation de Louis XIV était connue : ses conquêtes ne se limitaient pas aux femmes et aux filles des nobles de sa cour. Pauvre ou riche, négresse ou pas, qu’importait la condition : un joli minois condamnait une belle dame à ses rets !
Plutôt que de se laisser enfermer pour des raisons racistes dans la négation pure et simple de cette filiation entre Louis XIV et la religieuse noire de Moret, tout lecteur attentif sera contraint de se poser cette question déjà formulée par Jules Mathorez en 1919 : « Comment expliquer [sans cette filiation] l’intérêt porté par la cour à cette négresse ? »
Ce sont en effet les soins particuliers, que le roi prit à la formation de cette religieuse noire mais aussi pour lui garantir une existence commode, qui étonnent. Les documents d’archives consultés par Serge Bilé attestent que cette attention n’a jamais faibli jusqu’à la mort de Louis XIV. C’est dire combien ceux qui continuent à croire que la religieuse noire Louise-Marie de Sainte Thérèse – annoncée morte et réapparue après une vingtaine d’années de silence ! – est la fille de la reine et du nain noir Nabo, ne sont absolument pas crédibles.
Personne ne peut croire que Louis XIV, cocufié par la reine, se soit ardemment transformé en beau-père attentif et généreux au point de faire de cette jeune femme noire la prunelle de ses yeux et céder à ses volontés que Madame de Maintenon – sa dernière compagne – qualifiait de caprices. Signalons que la sœur Louise-Marie de Sainte Thérèse exigea et obtint en effet que le roi assistât à sa prise de voile le 30 septembre 1695. Elle avait alors trente-et-un ans.
Non, personne ne peut croire qu’un cocu publiquement humilié – l’accouchement d’une reine se faisant toujours en public – se plie aux caprices du fruit de l’adultère de sa femme ! Non, un cocu ne multiplierait pas les visites à la fille dont la naissance a souillé sa réputation devant la cour entière. Seules les femmes sont capables de ce dépassement ; pas les hommes, à moins que le cocufiage ne soit pas connu de tous. Il est certain que le défilé des princes de la cour au couvent de Moret s’explique par le fait que la négresse Louise-Marie de Sainte Thérèse était bien la fille naturelle du Roi Soleil. Nous pouvons dire, après l'abbé Pougeois qui fut curé à Moret, que « ce n'était sans doute pas fortuitement que la Mauresse portait en religion le nom de Louise-Marie de sainte Thérèse, c'est-à-dire les noms mêlés du roi et de la reine »
Louis XIV, père de deux filles noires !
Il nous a suffi de pousser un peu plus loin notre curiosité hors du livre de Serge Bilé, qui nous a permis de forger notre conviction, pour découvrir que selon Serge Aroles, « l’énigme de la fille noire de Louis XIV (est) résolue par les archives ». Oui, Serges Aroles montre clairement lui aussi, à travers les archives, que Louise-Marie de Sainte Thérèse – avec sa « triple dénomination alors rarissime, relevant quasi exclusivement de la haute noblesse » – est la fille de Louis XIV et non point celle de la reine Marie-Thérèse. Non seulement l’auteur affirme et démontre que la négresse de Moret est la fille du roi de France, mais aussi que celui-ci – toujours selon les archives – a eu une deuxième fille du nom de Dorothée, qu’il n’avait cessé de voir en cachette.
Voici l’introduction de son court texte : « Les archives sont souveraines : elles dédisent formellement trois siècles de littérature, qui n’ont point fait usage d’elles mais qui veulent que la fameuse « mauresse de Moret » eût été une fille que la reine de France aurait eue en 1664 d’un amant noir. Et les archives stupéfient. Il est une autre fille que Louis XIV protège de tous ses soins, mais tant secrètement qu’elle est restée inconnue jusqu’à nos jours : Dorothée, précieuse petite créature que le roi fait escorter de Paris à Orléans par son trésorier général de l’Artillerie ». Quand Dorothée, placée chez les Ursulines d’Orléans devait rejoindre un couvent proche de Paris pour y rencontrer le roi, elle jouissait d’une protection quasi militaire, fait remarquer Serge Aroles.
Autre détail de l’histoire qui tend à confirmer cette double paternité de Louis XIV, c’est que le luxueux carton sensé contenir les documents personnels de Louise-Marie de Sainte Thérèse nous est parvenu vide ; et quant à Dorothée, on a aussi pris soin d’effacer toute trace d’elle. Après leur mort, le vide trop soigneusement créé autour de ces deux femmes noires tend à confirmer leur lien de parenté avec le roi de France. Trop de « documents volés. Sans équivalent est l'absence de toute mention d'un acte de baptême [...] pour une religieuse bénédictine », fait remarquer Serge Aroles qui croit à une volonté délibérée d'effacer toutes les traces qui conduiraient à l'affirmation d'un quelconque lien de parenté entre les filles noires et Louis XIV. Il ne nous reste aujourd’hui, dans les archives, que peu de chose des enregistrements, au XVIIIe siècle, des minutes notariales disparues. Toutefois, « Louise et Dorothée, apparaissent […] – et avec quelle force pour cette dernière ! – dans les archives de la Maison du Roi. Que l’une ou l’autre eût été une enfant de la souveraine, elle apparaîtrait dans les comptes de la Maison de la Reine ». Ce dernier complément d’information lave la reine du soupçon de tout lien de sang avec l’une ou l’autre des deux femmes métisses.
Qui serait la mère de ces deux filles métisses ? Sont-elles sœurs ou demi-sœurs ? Sur ce chapitre, aucune certitude, selon Serge Aroles. Comme il n’y avait aucune servante noire, tant dans la « Maison du Roi » que dans la « Maison de la Reine », il émet l’hypothèse que ces filles seraient issues de « la petite noire vendue, jeune enfant, au premier comédien de Louis XIII, pour jouer les rôles de sauvage » que Louis XIV, amateur de théâtre, n’aura pas manqué de remarquer. Et, ajoute-t-il, si ces deux filles sont issues de la même femme, c'est qu'il y a eu relation amoureuse entre le roi et leur mère et non point une relation de passage. Logique !
Mais là où Serge Aroles surprend tout le monde, c’est quand il soutient – contre toutes les rumeurs du XVIIIe siècle – que la reine Marie-Thérèse n’a jamais accouché d’une fille noire. Selon lui, aucune correspondance entre les royaumes d’Europe (Autriche, Espagne, Grande-Bretagne, Vatican) ne mentionne ce fait. Or, ajoute-t-il, « malgré les alliances matrimoniales, ces puissances restaient ennemies de la France », et l’absence de pudeur et de retenue qui caractérisaient les lettres secrètes de l’époque n’auraient pas fait l’économie de l’information.
L’on peut donc dire que si l'enfant de la reine, né en novembre 1664, n'avait nullement la peau noire, c'est que cette histoire a été inventée comme un contre-feu aux naissances des enfants de Louis XIV. Oui, on peut imaginer que pour détourner l’attention de la cour et du peuple de ce qui lui arrivait, l’entourage du roi a propagé une nouvelle absolument fallacieuse. Et comme l’enfant de la reine est mort quelque temps après sa naissance, le public n’a pu, à l’époque, savoir la véracité de l’histoire.
Cette lecture de l'Histoire que fait Serge Aroles lave non seulement la reine de la calomnie qui la couvre depuis des siècles, mais confirme aussi le fait que Marie-Thérèse ne pouvait en aucune façon être la mère de la religieuse noire de Moret qu'elle n'a d'ailleurs pas souvent visitée. Cette présentation tend plutôt à montrer que ses zélés calomniateurs ne cherchaient et ne cherchent qu’à protéger l’honneur de Louis XIV. En juillet 2014, un article publié sur le site internet du journal Paris Match était ainsi intitulé : « Scandale à la cour : la reine Marie-Thérèse accouche d’un bébé noir ». Un article apparemment écrit pour dire que le déshonneur du roi de France est venu de l’Espagne, le pays de naissance de la reine. Son auteur ne tient aucun compte des documents d’archives et tend plutôt à déformer l’histoire quand il dit que le roi allait voir la négresse de Moret parce qu’il avait entendu dire que celle-ci avait des dons pour l’occultisme et aussi parce que « le roi, bon père pour tous ses enfants, ne se résignait peut-être pas à abandonner la fille de Marie-Thérèse, victime avec Nabo d’une faiblesse passagère à laquelle lui-même, des années durant, n’avait cessé de s’abandonner ». Ces lignes montrent de manière éclatante que la grossière tentative de falsification de l’Histoire poursuit son cours parmi nous. Mais cette fois, elle est devenue plus que ridicule ; elle est risible !
Raphaël ADJOBI
° Serge Bilé : La Mauresse de Moret, la religieuse au sang bleu ; édit. Pascal Galodé, 2012.
° Serge Aroles, L’énigme de la fille noire de Louis XIV résolue par les archives ? (sur Internet).
4 ans et demi après !

Dans la revue L'Histoire de mars 2019, c'est-à-dire quatre ans et demi après moi, un petit article (p.43) signé Joël Cornette fait la même analyse avec les mêmes éléments sans me citer ! Alors que jamais, avant moi, personne n'avait fait mention de Serges Aroles. Il finit son billet par une pirouette qui voudrait entretenir le négationnisme sans se rendre compte que son sentiment est aussi risible que celui de Paris Match : «Aucun document cependant ne permet d'étayer ces hypothèses. Le dossier Boinet 89 aux archives de la bibliothèque Sainte-Geneviève porte la mention manuscrite : "La Moresque Fille de Louis 14". Mais le dossier... est vide», affirme-t-il. Si le seul fait que le dossier est vide annule tous les indices qui trahissent la vérité, on peut conclure que peu de récits de l'histoire de France mériteraient d'entrer dans les livres d'histoire et dans les manuels scolaires. Le grand soin pris pour faire disparaître le dossier trouvé dans les affaires du roi est la preuve même que cette femme est la fille de Louis XIV ; le sentiment de Joël Cornette n'y change rien ! Joël Cornette aurait dû se poser cette question essentielle et élémentaire avant de conclure son article : pourquoi le dossier (même vide) d'une négresse se trouvait-il dans les affaires du roi de France ? Pourquoi n'a-t-on trouvé aucun document de cette fille dans les affaires de la reine ?
Serge Aroles a cité le livre de Serge Bilé sur son site Internet, par probité, parce que celui-ci a été le premier à aller très loin dans les recherches pour affirmer que la Mauresse de Moret n'est pas la fille de la reine. Suite à mon article, Serges Aroles m'a adressé des documents relatifs à "l'Homme au masque de fer" en me suggérant de les exploiter pour un travail équivalent à celui que je venais d'accomplir.