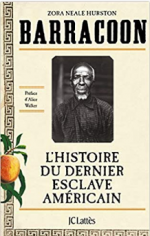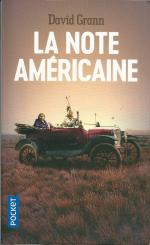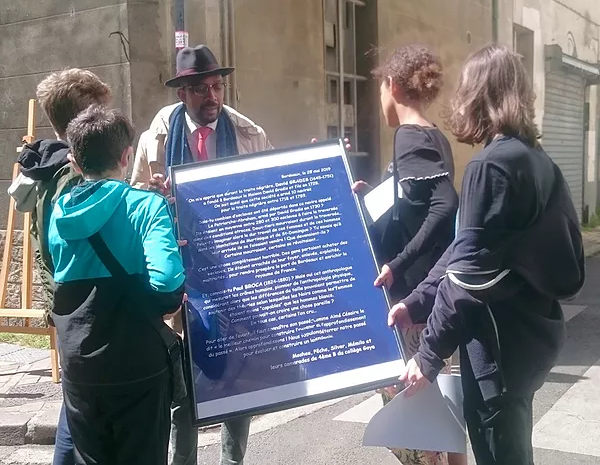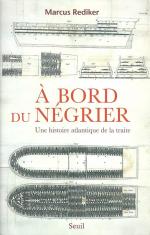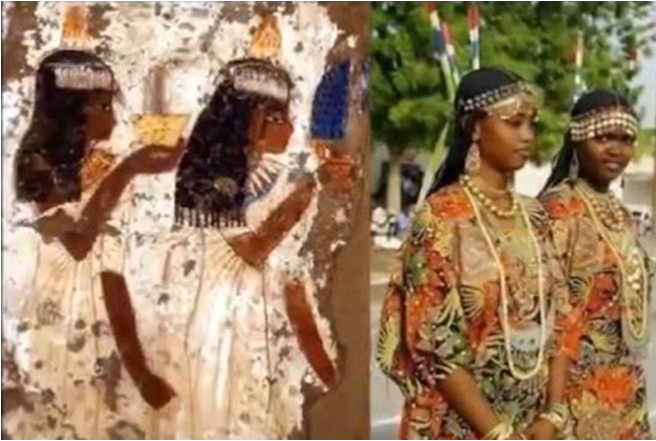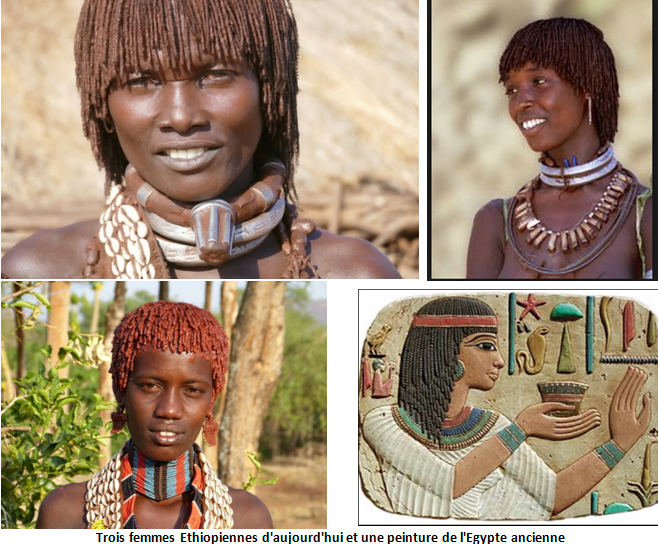La lecture, cette bienfaisante richesse que l'on néglige !
La lecture, cette bienfaisante richesse que l'on néglige !
Le 24 août 2019, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre une radio annoncer que, selon quelques chercheurs, la lecture serait un remède contre la dépression ! Fallait-il comprendre que la science ignorait le rôle thérapeutique de la lecture que les hommes de lettres et les amoureux des livres pratiquent et conseillent depuis si longtemps ? Maintenant qu'ils nous donnent raison contre les industries pharmaceutiques qui incitent les médecins à soumettre à un traitement médical fait de psychotropes tout enfant quelque peu agité ou instable, impulsif, étourdi ou tête-en-l'air, nous pouvons nous mettre à espérer que nous verrons bientôt des ordonnances rédigées en ces termes : «3 à 5 pages de lecture le matin ; 3 à 5 pages de lecture le soir». Une prescription à insérer dans la panoplie d'une éducation rigoureuse pour canaliser les caprices et les débordements des plus jeunes.
C'est ici l'occasion de rendre hommage à cette chef d'établissement qui a instauré dans son collège un temps de lecture pour tous - élèves, enseignants, les personnels de l'administration, de la restauration et de l'entretien ; et cela sans attendre l'avis des énarques qui empoisonnent notre système pédagogique par leurs réformes toujours incohérentes jamais précédées d'un état des lieux pouvant montrer que l'objectif visé correspond bien à un besoin réel des enfants ou de la société.
Le livre est non seulement un trésor de connaissances et donc de richesses mais il est aussi un soutien individuel parce qu'il est un instrument d'évasion, de voyages dans des contrées insoupçonnées pour vivre des vies et jouir de délices nécessaires à la régénération de notre esprit. Oui, la lecture, comme le disait si bien Arlette Laguiller, est le seul moyen de s'enrichir sans jamais rien voler à personne. Encourageons donc les jeunes générations à s'enrichir sans modération et sans scrupule ! Quant au pouvoir thérapeutique de la lecture, nous pensons qu'il est préférable de laisser la parole à quelqu'un qui l'a expérimenté. Voici ce qu'en dit l'écrivain Lionel Duroy : «Quand vous souffrez intensément, il y a toujours un livre essentiel pour venir à votre rencontre et vous sauver du désespoir. En 1990, au moment où j'ai rompu avec toute ma famille, je vivais avec Extinction, de Thomas Bernard, dans ma poche. Je relisais sans cesse ce passage où il parle de la haine que lui portent ses proches, et de sa façon de détourner cette haine contre eux [...] Quand je vais très mal, j'entre dans une librairie, je demande un livre de secours, puis je me mets à lire et je ne suis plus là. Voilà toute la magie de la littérature : vous disparaissez de la réalité» (Propos recueillis par Marine Landrot ; Télérama n°3632 du 24 août 2019).
Tous les amoureux de la lecture savent, comme Lionel Duroy, que quand la vie nous apparaît profondément décevante, le livre devient un îlot de sauvetage, un lieu vivable. Apprenons donc à prendre le temps de nous asseoir, le temps d'ouvrir un livre et d'entreprendre un voyage vers un univers toujours vivable pour notre esprit et pour le bien notre corps.
Raphaël ADJOBI