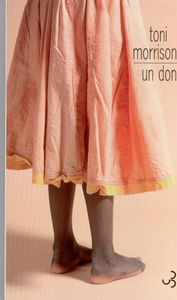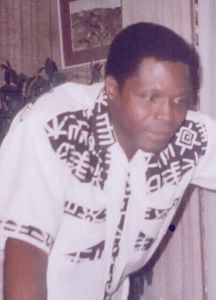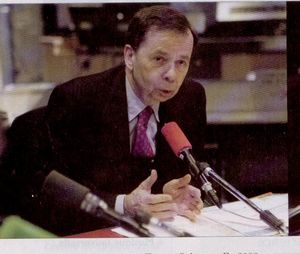Entretien avec Delugio
auteur du blog « Une vingtaine »
Poursuivant mon projet de vous faire connaître davantage des blogueurs africains ou afrodescendants, je vous propose ici le deuxième « entretien » de la série initiée au début de cette année. Mon invité est le franco-ivoirien Delugio, auteur du blog « Une Vingtaine ». Je vous conseille vivement de commencer par lire les questions posées.
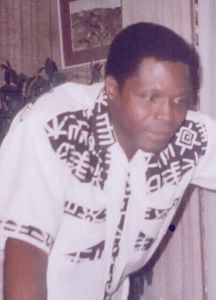 1. Qui est Delugio derrière le blog UNE VINGTAINE ?
1. Qui est Delugio derrière le blog UNE VINGTAINE ?
Quelqu’un qui a commencé à bloguer par hasard ! L’aveu par la ministre française de la Défense Michelle Alliot-Marie d’ « une vingtaine » de morts ivoiriens du fait de l’armée française (chiffre pour le moins à minima ! – après des jours de dénégation) m’a fait réagir à l’article annonçant cela dans nouvelobs.com, lequel m’a orienté vers l’ouverture d’un blog (intitulé dès lors « une vingtaine »)…
Façon de faire acte de civisme, en deux sens. Comme français, je suis convaincu que le pacte colonial qui est derrière la raison d’Etat et cette façon de gérer les pays de la zone franc CFA (donc sans indépendance économique) est nuisible non seulement aux populations desdits pays, mais aussi à la France. Et par ailleurs, ayant été élevé au statut correspondant à ma classe d’âge dans le peuple adjoukrou, j’y ai des responsabilités afférentes, que j’exerce de cette façon-là : témoigner par la plume, ou le clavier…
J’ai fait cela en étant conscient de la dimension parfaitement hérétique, dans la pensée ambiante, des positions qu’il fallait prendre sauf à succomber à la lâcheté. Hérétique comme le nom de Lugio : déjà celui d’un cathare médiéval taxé alors d’ « hérétique » ! Puis celui d’une lignée apache (on ne peut plus décalé donc, par rapport à la nome), sans compter l’évocation du déluge sur lequel ne pouvaient que déboucher les événements culminant en 2004 – pour basculer dans l’ironie où on se trouve à présent, quand le nom Delugio évoque carrément un jeu pour enfants !…
2. Est-ce délibérément que tu publies moins depuis la création de ton nouveau blog ou parce que tu n’as pas encore trouvé, de manière claire, la direction à lui donner ?
En fait, j’ai diminué mes publications progressivement depuis que les médias français ont cessé de prendre la Côte d’ivoire et son pouvoir comme un déversoir de fiel. J’ai annoncé la fin de mes notes sur nouvelobs.com le 30 novembre 2008, soit quatre ans jour pour jour après le début de mon blog. Depuis, mon blog nouvelobs.com a disparu(j’ai reconstitué toutes mes notes sur mon blog wordpress). Il a disparu (en 2004) pour des raisons que l’on ne m’a toujours pas dites, mais qui me laissent penser que cette fin de blogging a été reçue comme un soulagement par la direction du Nouvel Obs, qui m’a fréquemment (et « officiellement ») censuré auparavant – le Nouvel Obs ayant toujours été dans la ligne du pouvoir français concernant la « crise ivoirienne ». La censure devenant trop régulière, j’en étais venu dès 2006 à ouvrir deux autres blogs (sur zeblog et hautetfort) !… Tentant déjà de privilégier une mise en perspective outre les événements au quotidien. (Allant d’analyses avec le recul à des réflexions sur les aspects corollaires des choses - de l’idéologie coloniale au mythe de la « hiérarchie des races », et quelques morceaux d’actualité qui peuvent s’y rapporter, jusqu’à aujourd’hui.)
Concrètement, la diminution progressive du rythme de publication de mes notes correspond aux suites de l’accord de Ouagadougou. J’ai effectivement, depuis, publié de moins en moins de notes sur le sujet : il n’y a, pour l’instant, plus grande chose à dire en regard de l’objet premier de mon blog.
Je me suis bien sûr réjoui de l’accord de Ouaga, qui mettait fin aux violences. Une joie amère toutefois – et qui débouche sur un « wait and see », au de-là de la satisfaction évidente de la nébuleuse françafricaine, qui semble avoir retrouvé ses billes, avec, en contrepartie pour la Côte d’Ivoire, l’apaisement des médias français.
3. Il me semble que tu es sorti meurtri du combat que tu menais par l’intermédiaire de ton précédent blog. N’es-tu pas un peu traumatisé, comme bien des Ivoiriens, à l’issue des périodes troubles qu’a connu la Côte d’Ivoire ?
Meurtri, ce n’est pas le mot. Instruit serait plus juste. J’ai illustré cela dans la page « à propos » de mon blog wordpress, par le mythe développé par Stephen King dans son livre Les Tommyknockers, que j’utilise comme métaphore de la fameuse « françafrique » et de sa découverte : l’héroïne du livre butte sur une petite excroissance sur son chemin, pour finir par déterrer une réalité monstrueuse.
C’est cette réalité que l’on décrète morte, que l’on dit n’être plus à l’ordre du jour chaque fois qu’elle refait parler d’elle : l’ineffable « françafrique ».
J’ai découvert que les hommes politiques au fait de ce qui se passait finissaient par ne plus parler pour garder leur crédit, tout en ne trahissant pas les socialistes ivoiriens (Mélanchon, Emmanuelli), quand d’autres franchissaient le pas de la trahison de leurs alliés africains (Besson, Montebourg) ; même en sachant pertinemment ce qu’il en était (Hollande) : tous ceux-là rejoignant, au moment des exactions françaises, le pouvoirs d’alors (Chirac-Raffarin) en raison d’Etat.
Cela sans parler des médias. Mais comment pouvait-il en être autrement quand les médias sont aux mains de propriétaires français de l’économie ivoirienne ? Le proverbe africain résume l’idée : « celui qui mange à la table du roi ne peut pas dire la vérité au roi ».
Le tout sur l’air bien-pensant de la fameuse lutte contre le « racisme ivoiritaire », les médias faisant l’opinion et réciproquement.
Il y a effectivement de quoi être traumatisé quand on sait que derrière tout cela il y a des milliers de meurtres perpétrés par la rébellion protégée par ces mêmes intérêts (et par le silence de nos médias) grimés de bien-pensance.
Du coup, oui, Ouagadougou est un apaisement, mais un apaisement amer, consacrant l’impunité… Jusqu’à quelles élections ?
4. Crois-tu sincèrement à des élections présidentielles en Côte d’Ivoire en 2009 malgré des populations disséminées, une administration quasi absente dans le Nord et la présence de deux armées sur le territoire ?
Si ce n’est pas une gageure que de mettre en place des élections quand la moitié du territoire échappe à l’administration républicaine, restant aux mains des bandes armées (dites « ex »-rébelles) qui font leur beurre ; si ce n’est pas une gageure, c’est au moins un défi.
Le défi à relever pour aller au-delà de la situation résultant de la mise en place de la « force d’interposition ». Interposition en l’occurrence entre l’état républicain légitime et les bandes armées qui n’ont d’autre légitimité que celle de leurs armes !
… Sans compter que la crise, commencée depuis 1999 avec les démêlés Bédié-Ouattara, a dévoilé que lorsqu’un candidat « d’opposition », lors d’élections africaines, a la faveur de la « communauté internationale » et des médias (qui ne négligent rien en sa faveur), c’est qu’il a les mêmes positions économiques que son concurrent « usé »… Il suffit qu’on lui trouve toutes les vertus de la bien-pensance parisienne, pour en faire un candidat de la « post-françafrique » ! – quitte à calomnier médiatiquement tous les autres.
C’est ce qui fait craindre pour l’avenir : je crains que le bras de fer Gbagbo-Françafrique, qui a été une occasion unique en Afrique, n’ait trouvé ses limites.
Une fenêtre de tir vers un renouveau en Afrique – auquel la France aurait déjà pu oser ne pas s’opposer – avait pourtant été ouverte après l’élection de 2000. Ou bien il n’est toujours pas trop tard, ce que pourraient dire les élections à venir, ou bien il faudra se contenter d’espérer la prochaine ouverture. Reste que l’histoire est écrite, qui ne pourra être effacée : quelque chose à bien eu lieu, un autre possible s’est esquissé.
5. Que penses-tu des blogs africains ?
Je suis ravi. L’ouverture de blogs ivoiriens est un des éléments qui ont contribué à la réduction de mes productions de blogeur. En 2004, j’étais, à ma connaissance, le seul blogeur écrivant sur la « crise ivoirienne » ! Je publiais alors, outre mes analyses, des articles de journaux ivoiriens (ou autres, comme par exemple ceux du journal burkinabé San Finna) – déjà publiés sur le net, mais de la façon éphémère des journaux.
Je publiais notamment des textes de Théophile Kouamouo, jusqu’au jour où il s’est mis à bloguer. : il me suffisait désormais de faire des liens. Puis sont apparus aussi Saoti, le blog « couper-coller » de CC, Yoro, Y-voir-plus, le tien, etc. (Je limite ma liste qui serait trop longue ! Voir les liens – non exhaustifs ! sur mon blog.)
Une véritable libération de la parole en Afrique – une véritable promesse.
6. Que penses-tu des récents travaux entrepris en Côte d’Ivoire par Israël Yoruba et Théophile Kouamouo pour la vulgarisation des blogs dans ce pays ?
Leur travail est évidemment, et en tête, dans cette promesse de la libération de la parole, qu’ils promeuvent de façon efficace et précieuse. Le nombre des blogs est déjà considérable : comme je viens de le dire en ne citant que les plus anciens, on ne peut déjà plus être exhaustif.
Et quand on sait le rôle que le débat par la plus et le clavier joue comme alternative à des crises pouvant devenir plus… physiques, comment le dialogue nuance les pensées, et, en même temps permet de dénoncer ce qui n’a pas lieu d’être, il y a tout lieu de s’en réjouir.
Entretien réalisé par
Raphaël ADJOBI