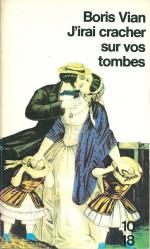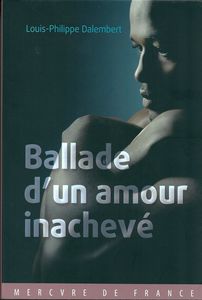CACAO (un roman de Jorge Amado)
CACAO
(un roman de Jorge Amado)
Hier comme aujourd'hui, en ce XXIe siècle, on jette aux pauvres ces paroles amères qui résonnent comme des coups de pistolet : « Si vous êtes pauvres, c'est parce que vous ne travaillez pas assez ! » Et pourtant, aucun pauvre n'est devenu riche en travaillant comme un forçat au service d'un maître, planteur ou industriel. Et cela parce que c'est la force des bras des pauvres qui fait la fortune de ceux pour qui le mot « travail » se confond avec les chiffres des comptes en banque. En effet, pour un « capitaliste », il faut surveiller et parfois battre ceux qui triment dans les champs ou sur les machines afin que le capital prospère.
Cacao est un récit simple et dur dont l'action se déroulant dans une cacaoyère au sud de l'Etat brésilien de Bahia illustre admirablement cette vision du monde où l'ouvrier est le damné de la terre sans aucune chance d'émerger de son état. C'est dans cet univers où l'on loue la force de ses bras pour travailler à la journée avec un salaire dérisoire qu'un revers de fortune va plonger un jeune Blanc au début du XXe siècle. Très vite, il découvre la dure loi des immenses plantations, véritables sociétés où les ouvriers sont obligés de faire leurs courses à l'économat du domaine, une sorte de magasin appartenant au maître lui permettant de reprendre l'argent qu'il a donné.
Au-delà de l’organisation sociale qui ressemble à un engrenage parce que l'ouvrier est privé de toute possession particulière pouvant générer une entreprise particulière hors de la domination du maître, ce qui retient l'attention du narrateur blanc et donc du lecteur, ce sont les limites étroites de la vie et de l'avenir des hommes dans ces hameaux des plantations faits de cabanes à une seule pièce où ils s'entassent. Chaque jour, les pères désespèrent de voir leurs filles de douze ou treize ans dépucelées par les fils des maîtres et condamnées ensuite à aller grossir les rangs des prostituées. Tous vivent avec un attachement excessif à la pratique de la religion car la morale chrétienne leur tient lieu de boussole quand il s'agit de défendre leur honneur et surtout celui de leurs filles. Dans ce monde où l’on subit le mépris sans pleurer, on n’apprend qu’une chose : la haine.
Cette peinture de la société du monde paysan brésilien révèle deux choses : aucun pauvre ne peut devenir riche s'il n'a pas de bien à faire fructifier. Et c'est dans l'intérêt du capitaliste de faire en sorte que le pauvre ne soit pas le maître de lui-même : il ne peut servir deux maîtres à la fois ! D'autre part, la liberté qu'avaient tous les riches Blancs, ainsi que leurs enfants mâles, de coucher avec les filles noires et métisses a très largement contribué à faire du Brésil une société métissée. On peut tout simplement ajouter que cette pratique n'est que la résultante d'une autre remontant à l'époque de l'esclavage : les riches propriétaires constituaient des haras humains où ils ensemençaient eux-mêmes leurs esclaves femelles pour obtenir des espèces métissées vendues à un meilleur prix. Résultat : aujourd'hui, dans ce pays où les Noirs ne représentent que 7,7% de la population, les métis dépasse le seuil de 43% alors que la population blanche se situe à 47,7%.
Assurément, Cacao est un roman fait pour la réflexion sur le sort de ceux qu'on appelle les damnés de la terre et qui sont légions en Amérique latine et en Afrique où prospère, depuis des siècles, le capitaliste blanc.
Raphaël ADJOBI
Titre : Cacao, 155 pages
Auteur : Jorge Amado
Editeur : J'ai lu, 2012